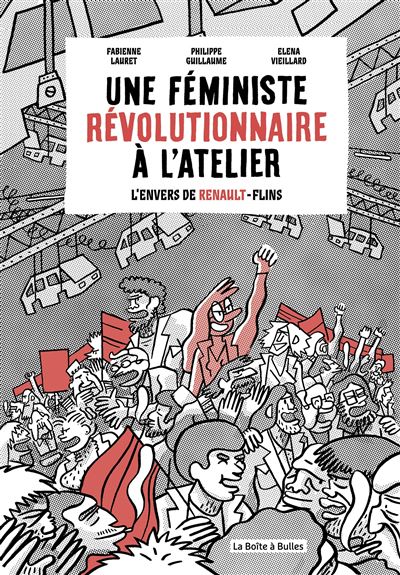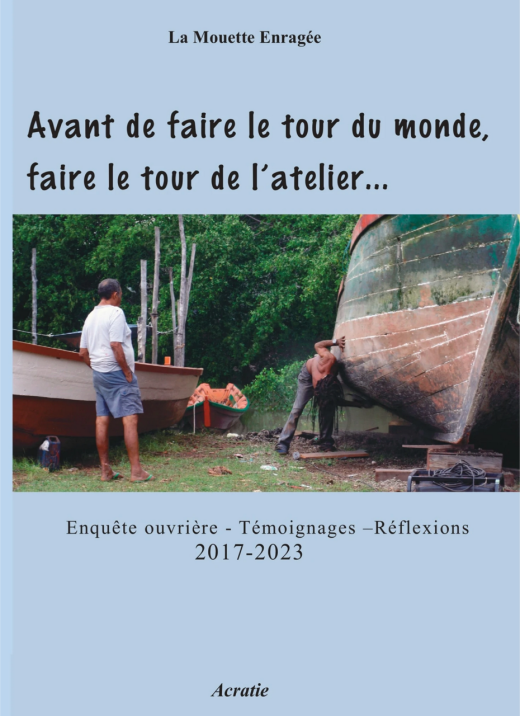
Vous pouvez écouter la présentation du livre ; Avant de faire le tour du monde, faire le tour de l’atelier… une enquête ouvrière réalisée par le groupe ; La mouette enragée aux éditions Acratie. Cette présentation a eu lieu à L’EDMP, à Paris, le 8 février 2025.
- La mouette enragée BP403
- 62206 Boulogne sur mer Cedex
- lamouette.enragee@gmail.com
Ils se sont connus sur le port de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), lors des barrages contre la réforme des retraites en 2010. Ils avaient tous deux 22 ans. Fabien occupait son premier poste de professeur d’histoire-géographie, Arthur terminait un master en contrat professionnel dans une entreprise de valorisation des déchets de la pêche. Ensemble, ils ont rejoint la Mouette enragée, un groupe communiste anarchiste qui publie un journal du même nom depuis 1992, toujours disponible dans les kiosques de Boulogne. Ils se veulent les héritiers d’une vieille tradition antiautoritaire propre à la ville portuaire.
Dynamique des mouvements sociaux
Pas de quoi fomenter une révolution : s’ils furent jusqu’à huit dans le groupe il y a quelques années, ils ne sont plus que quatre, dont Arthur, parti travailler dans une ressourcerie à Marseille. Mais ils croient à la dynamique des mouvements sociaux pour « renverser les rapports de force ».
Leur conviction : le travail est une question politique, car il est au cœur du système capitaliste. « La question n’est jamais travaillée dans les milieux qui réfléchissent à la transition écologique, regrette Fabien, aujourd’hui enseignant dans un collège à Lille. C’est ce qui explique en partie que l’urgence climatique n’est pas une priorité pour les travailleurs. »
Les membres de la Mouette enragée se sont lancés entre 2017 et 2023 dans la réalisation d’une « enquête ouvrière » qui donne à voir les conditions de travail des salariés en bas de l’échelle sociale et de l’échelle des salaires, dans des entreprises des Hauts-de-France et de Bretagne. Le fruit de leur travail a paru sous le titre Avant de faire le tour du monde, faire le tour de l’atelier… (Acratie, 2023).
Le groupe s’est inscrit dans une tradition qui remonte aux débuts de l’industrialisation. Les premières enquêtes ouvrières sont réalisées par des hauts fonctionnaires, des ingénieurs ou des médecins comme Louis René Villermé, qui publie en 1840 un livre sur les ouvriers des manufactures textiles. En 1843, la féministe socialiste Flora Tristan réalise un Tour de France en vue d’un « état actuel de la classe ouvrière sous l’aspect moral, intellectuel, matériel ».
La plus célèbre enquête ouvrière est celle que Marx a publiée en 1880 sous le titre « l’Enquête ouvrière » et publiée dans La Revue socialiste. Le Belge Joseph Cardijn, fondateur de la Jeunesse ouvrière chrétienne en 1925, inscrit, lui, l’enquête au cœur de la méthode Jociste. On pense aussi aux écrits de Simone Weil en 1950. La tradition ressurgit dans les années 1960 en Italie, en France, en Angleterre, avec la volonté de réaliser un état des lieux réflexif mené au sein du monde ouvrier, un outil à part entière de la lutte des classes et non une étude sociologique à prétention scientifique.
Logistique et centres d’appels
L’équipe de la Mouette enragée a rencontré plusieurs dizaines de femmes et d’hommes travaillant dans le secteur privé, de tous âges, en CDD, en CDI ou en intérim. Dans le nord, ces emplois sont occupés par les enfants et petits-enfants des générations employées dans le charbon, le textile, la sidérurgie. Tous décrivent comment la taylorisation colonise une large part de l’industrie des services. C’est le cas dans la filière logistique, cinquième recruteur en France, avec 1,8 million d’emplois, quatre fois plus que l’automobile. On lit dans l’ouvrage les réponses de salariés de Vertbaudet, la Redoute, Amazon à un questionnaire très précis sur l’entreprise, les conditions de travail, l’argent, la hiérarchie, les collègues, les luttes.
Une vingtaine d’employés de centres d’appels ont accepté de répondre aux questions, dessinant un « prolétariat digital mais pas virtuel », « une tendance à la déqualification sociale du travail qui valide la disparition du métier au profit du job et de la fonction interchangeable ».
Quant à la production agroalimentaire, elle occupe une place dominante dans les Hauts-de-France, où elle emploie 70 000 salariés. À Boulogne, premier port de pêche français, les travailleurs de ce secteur se concentrent dans la zone industrielle de Capécure, qui regroupe 150 entreprises, première place de transformation de produits de la mer d’Europe. Partout, le travail est dur et le taux de rotation très important.
Abstention et vote sanction
« Nous avons été surpris par une constante un peu partout, relève Arthur : le matériel est mal entretenu. Les outils tombent très souvent en panne et leur obsolescence est à l’origine d’accidents du travail. On pourrait s’attendre à ce que les industriels investissent dans les machines pour augmenter la productivité, mais non. Celles-ci sont poussées à bout, comme les corps. »
« Nous avons aussi découvert qu’il existe de nombreux petits gestes de résistance, même si les salariés sont souvent fiers de leur entreprise. Il y a beaucoup de débrayages pour des augmentations de salaire au moment des négociations annuelles obligatoires, ou bien pour obtenir des pauses supplémentaires pendant les grandes chaleurs. Cependant, s’ils ont conscience d’être exploités, ils n’ont pas celle d’appartenir à une classe sociale qui pourrait être une actrice politique », ajoute Fabien. D’où l’abstention et le vote sanction.
« Je me suis politisé avec le CPE (contrat première embauche, spécifique aux moins de 26 ans, abandonné à la suite d’immenses manifestations en 2006, NDLR), raconte Arthur. Ce fut notre dernière victoire. Depuis, les mouvements sociaux n’ont fait qu’essuyer échecs sur échecs. Après des manifestations qui pourtant mobilisent des foules, les gens retournent au boulot, dépités. Soit, ils ne vont plus voter, pour la plupart, soit ils votent pour ceux qu’ils n’ont jamais essayés ».