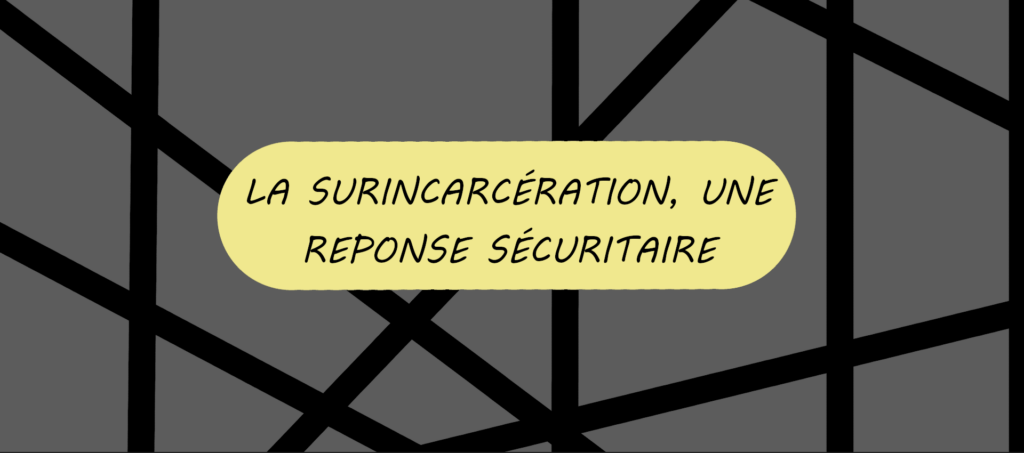
Nous avons invité L’OIP (l’Observatoire International des Prisons) pour parler du durcissement constant des politiques pénales, que les gouvernements successifs accentuent, conduisent déjà à des niveaux de surpopulation carcérale sans précédent : plus de 127% d’occupation en moyenne dans les prisons françaises ; près de 154% dans les maisons d’arrêt, où sont incarcérées près de sept personnes détenues sur dix, en attente de jugement ou condamnées à des peines inférieures ou égales à deux ans ; plus de 200% dans au moins dix-sept quartiers de détention. Les conditions de détention sont de plus en plus indignes, avec des personnes détenues qui s’entassent à deux ou trois dans des cellules exiguës, et 3 609 d’entre elles qui dorment sur des matelas de fortune posés à même le sol[1]. L’accès aux soins, aux activités et à l’accompagnement est toujours plus illusoire, aux antipodes de l’objectif de réinsertion fixé par la loi. Les conditions de travail du personnel pénitentiaire sont si dégradées que les vacances de poste sont légion.
La seule réponse face aux désastre des politiques pénales consiste à construire de nouvelles prisons, cette politique immobilière n’a fait que permettre d’incarcérer toujours plus. Chaque mois la Franc explose son record de taux d’incarcération. Entre 1990 et 2024, le nombre de places de prison a augmenté de 25 152, et celui des personnes détenues de 30 477. Les prisons françaises enferment déjà près de 4 000 personnes de plus que le nombre de places prévu à l’horizon 2027. En phagocytant le budget de l’administration pénitentiaire au détriment de la rénovation des prisons déjà existantes, du développement des dispositifs d’insertion et de l’accompagnement des personnes détenues, cette politique est en outre largement contre-productive. Le nombre de prisonniers pour 100 000 habitants et la durée de détention moyenne ont doublé en quarante ans – sans rapport avec les courbes de la délinquance. Que toujours plus de comportements sont passibles d’emprisonnement et que les peines encourues ne cessent de s’alourdir. Et malgré les faits l’opinion publique, matraquée par les mensonges médiatiques est amenée à penser que la justice comme trop laxiste, au diapason de la plupart des professionnels du secteur. Il vous appartient d’œuvrer à faire connaître ces tendances. Le gouvernement parle à la place des français « les Français demandent » alors qu’ils reflètent surtout les fantasmes d’une partie de la classe politique. « Les Français demandent […] à ce que les peines soient réellement exécutées », dites-vous, suggérant que ce n’est pas le cas alors que 95% des peines de prison ferme sont mises à exécution, d’après le ministre de la Justice. La loi pose au contraire l’aménagement des fins de peines comme un principe, destiné à faciliter la difficile transition entre détention et liberté, pour le plus grand bénéfice de la société. deux tiers des personnes détenues condamnées sortent de prison sans y avoir accédé.
Deux mutineries quasi simultanées, le 28 septembre 2024, ont rappelé l’ampleur des tensions qui s’accumulent dans les prisons françaises, toujours plus surpeuplées.
À la maison d’arrêt de Nîmes, une centaine de prisonniers ont refusé de regagner leurs cellules pendant plus de quatre heures, le 28 septembre, pour dénoncer des conditions de détention inhumaines. Cette prison est par ailleurs infestée de rongeurs et de punaises de lit : 267% d’occupation au quartier hommes, où des matelas au sol ont été installés dans presque toutes les cellules. Le même jour, une mutinerie éclatait au quartier centre de détention de Majicavo (Mayotte), où la surpopulation, chronique, atteint là aussi 267%.

